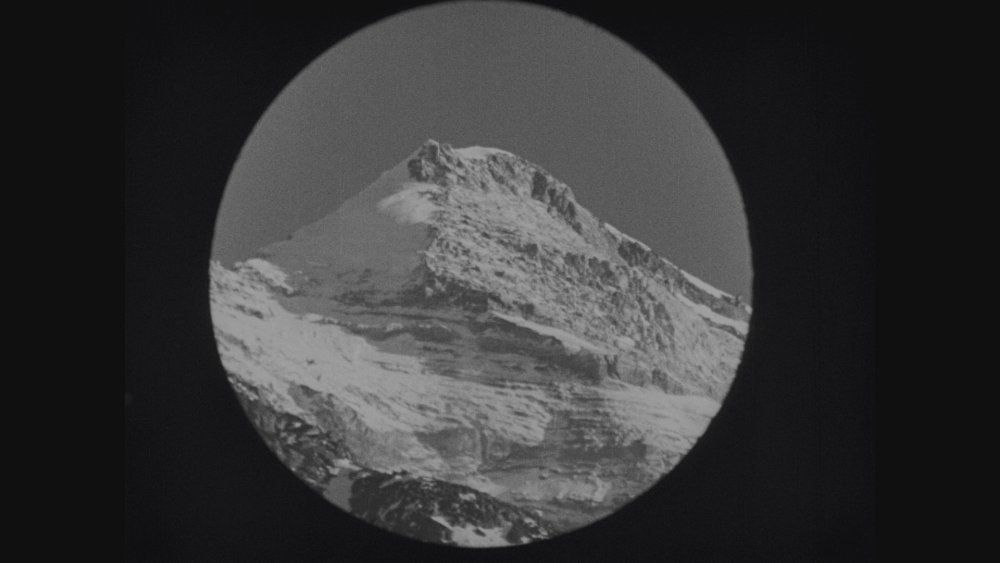Des premiers films tournés par Sjöström aux Etats-Unis, il ne reste rien: celui-ci, très connu et suscitant souvent l'admiration des critiques, est donc le plus ancien témoignage de cette période féconde et brillante, mais durant laquelle le metteur en scène Suédois a du céder de plus en plus de terrain à la MGM, sans pour autant acquérir de manière significative de grands succès... Et c'est aussi un grand moment historique pour la compagnie, qui héritait du contrat Goldwyn du réalisateur: c'st en effet très officiellement avec ce film que la Metro-Goldwyn, qui sera bientôt allongée en Metro-Goldwyn-Mayer, débutait sa production.
Des premiers films tournés par Sjöström aux Etats-Unis, il ne reste rien: celui-ci, très connu et suscitant souvent l'admiration des critiques, est donc le plus ancien témoignage de cette période féconde et brillante, mais durant laquelle le metteur en scène Suédois a du céder de plus en plus de terrain à la MGM, sans pour autant acquérir de manière significative de grands succès... Et c'est aussi un grand moment historique pour la compagnie, qui héritait du contrat Goldwyn du réalisateur: c'st en effet très officiellement avec ce film que la Metro-Goldwyn, qui sera bientôt allongée en Metro-Goldwyn-Mayer, débutait sa production.
Le lion de la MGM, dès 1923, annonçait au public que le long métrage qu'ils allaient voir était un "Goldwyn picture". ce n'est pas avec ce film qu'il a donc fait son entrée en piste. Mais l'animal joue malgré tout un rôle dans He who gets slapped, aux côtés, rien que ça, de Norma Shearer, John Gilbert, Tully Matshall, Ford Sterling, Marc McDermott... et Lon Chaney. Adapté de Leonid Andreyev, le film a une intrigue très européenne, qui aurait fait un film Russe, Français, Allemand... ou Suédois tout à fait conforme à ce qu'on attendait du cinéma de ces pays: un scientifique, Paul Beaumont (Chaney) a dédié sa vie à prouver des théories scientifiques, et il arrive enfin à son but. Avec l'aide de son mécène, le baron Régnard (McDermott), il va présenter à l'académie des sciences de Paris sa trouvaille... Mais le jour venu, le baron, qui bénéficie du soutien de Mme Beaumont (Ruth King) elle-même, s'approprie purement et simplement le crédit de la découverte, allant jusqu'à gifler Beaumont lorsque celui-ci essaie de se défendre. Le rire qui s'empare de l'auditoire va lui donne, par la suite, une idée morbide...
On retrouve Beaumont à Paris, divorcé et devenu incognito le clown vedette d'un cirque. Sous le nom de "He who gets slapped (Celui qu'on gifle)", il rejoue invariablement cette scène, lâchant face à soixante clowns assis devant lui, les unes après les autres, des théories scientifiques vagues et contradictoires, qui finissent invariablement par lui attirer une gifle. A la fin du numéro, Chaney se fait tuer, et on arrache symboliquement son coeur... Il remporte un immense succès, et tout se passerait assez bien, s'il ne tombait pas amoureux de la belle Consuelo Mancini, fille d'un comte désargenté (Shearer et Marshall), qui est venue travailler en tant qu'écuyère pour le cirque. Car non seulement Consuelo aime l'acrobate Bezano (gilbert), qui le lui rend bien, mais en prime, elle est appelée à se marier à un noble...
...Le baron Régnard, qui en goujat parfait a rendu sa liberté à la traîtresse Mme Beaumont. A ce stade, Beaumont qui n'a jamais cédé au désespoir, va cette fois céder, purement et simplement, à la folie de la vengeance...
Le film suit fidèlement, ou presque, un schéma d'intrigue qui a souvent servi pour les histoires construites autour de Lon Chaney: The penalty, de Wallace Worsley, ou West of Zanzibar de Tod Browning font partie de ce cycle. Le personnage subit un traumatisme initial, qui revient pour lui imposer un désir de vengeance, dans lequel il va se perdre, mais risquera aussi de perdre avec lui une femme: un amour, ou éventuellement dans le film de Browning, sa fille. Plus généralement, 'idée de vengeance fait partie intégrante de la mythologie de l'acteur... Mais ici, Sjöström nous intéresse à ce drame étrange, autant pour ses ramifications dramatiques, que pour la vie des artistes qui sont amenés à le rejouer soir après soir. Et le film utilise un leitmotiv, celui d'un clown hilare qui fait tourner un globe terrestre, pour passer d'une étape à l'autre. Le prologue du film fait s'enchaîner la vision du clown, et celle de Beaumont qui effectue ses expériences; l'épisode qui nous présente le cirque, quant à lui, introduit un nouveau motif: des clowns qui descendent sur un ring, au moyen de cordes, et qui s'installent en spectateurs muets mais mobiles de la répétition de mouvements par un petit aspirant clown qui est malmené par son professeur. cette anecdote nous permet de faire la connaissance de Bezano, le coeur d'or, soit John Gilbert: le rival de Chaney échappera à sa vengeance...
Car le film nous intéresse beaucoup au cirque, qui devient le principal non le seul, ancrage des personnages, et donc du drame. Vrai, le cirque est dominé par "He" et son succès, mais il n'est pas le seul à se promener en permanence en costume. La vie, le cirque, il n'y a plus de différence. C'est d'ailleurs le sens de ces constantes références au clown qui fait tourner sa mappemonde, et de ce ring qui se mue à la fin en globe terrestre. Pour appuyer ceci, Sjöström s'amuse à multiplier les présences de cercles dans un grand b=nombre de plans. Il utilise aussi beaucoup la cruauté, pour raconter le parcours tragique de cet homme dont l'histoire ici commence par une humiliation qui aurait du être sa fin... Pourtant Beaumont survit, et accomplira son destin dans la vengeance et dans la mort... en passant par l'échec de l'amour: avec son épouse, d'abord, qui ne lui témoigne qu'une froide indifférence au début, puis avec Consuelo, qui prend la déclaration enflammée du clown pour une nouvelle blague... En riant, elle lui décoche donc... une gifle; mais par gentillesse! Norma Shearer et John Gilbert sont bons, un peu en retrait sans doute, mais on voit que la MGM a demandé à Sjöström de leur donner un peu d'espace, afin de préparer l'avenir: le film, rappelons-le, est un labratoire de la "formule" MGM, et doit contenir tout le savoir-faire du studio. L'un et l'autre h=joueront un rôle important dans l'avenir de la firme.
Venons-en à ce paradoxe: s'il est courant de voir que le personnage de Chaney ne survit pas au film, ici, il met quand même deux bobines à mourir. On pourrait même argumenter du fait qu'il en met sept, puisque tout le film va vers sa disparition, d'abord sociale, avant d'être physique. Mais Chaney reçoit un coup d'épée fatal au début de la sixième bobine, et va ensuite agoniser lentement, assistant d'ailleurs au repas d'un lion (Qui mange McDermott et Marshall), dans une scène morbide. Enfin, il se relève,e t mourra en scène dans une scène à la cruauté démesurée... Pour finir, les clowns réunis dans un plan symbolique le jettent à l'extérieur du ring. Le film est noir, et nous présente la vie comme une loterie, dans laquelle l'humiliation, l'échec et la jalousie, entremêlés de vengeance, entament devant nous une danse de mort interprétée... par des clowns. Sjöstrôm avait réussi un chef d'oeuvre.






 Des premiers films tournés par Sjöström aux Etats-Unis, il ne reste rien: celui-ci, très connu et suscitant souvent l'admiration des critiques, est donc le plus ancien témoignage de cette période féconde et brillante, mais durant laquelle le metteur en scène Suédois a du céder de plus en plus de terrain à la MGM, sans pour autant acquérir de manière significative de grands succès... Et c'est aussi un grand moment historique pour la compagnie, qui héritait du contrat Goldwyn du réalisateur: c'st en effet très officiellement avec ce film que la Metro-Goldwyn, qui sera bientôt allongée en Metro-Goldwyn-Mayer, débutait sa production.
Des premiers films tournés par Sjöström aux Etats-Unis, il ne reste rien: celui-ci, très connu et suscitant souvent l'admiration des critiques, est donc le plus ancien témoignage de cette période féconde et brillante, mais durant laquelle le metteur en scène Suédois a du céder de plus en plus de terrain à la MGM, sans pour autant acquérir de manière significative de grands succès... Et c'est aussi un grand moment historique pour la compagnie, qui héritait du contrat Goldwyn du réalisateur: c'st en effet très officiellement avec ce film que la Metro-Goldwyn, qui sera bientôt allongée en Metro-Goldwyn-Mayer, débutait sa production.