O. Henry's full house (Henry Koster, henry Hathaway, Jean Negulesco, Howard Hawks, Henry King, 1952)
 Production de prestige s'il en est, ce film n'est bien sûr pas tout à fait un long métrage réalisé par cinq réalisateurs de renom... C'est l'une anthologie de cinq adaptations de nouvelles de O.Henry, écrivain immensément populaire dont la Fox a souvent tiré des films... Et afin d'assumer le prestige jusqu'au bout, le producteur Andre Hakim a demandé à John Steinbeck lui-même de faire des apparitions dans le film, pour y introduire chacune des histoires. les ambiances sont fort différentes d'un court métrage à l'autre, en fonction bien sur du ton de chaque nouvelle. Mais la compagnie a vraiment mis les petits plats dans les grands en convoquant un casting de rêve... Comme toute anthologie, le film a ses hauts et ses bas, c'est a raison pour laquelle je vais, de façon succincte, plutôt me livrer à une brève description et une courte critique de chaque segment. Pour le reste, le film réussit bien à donner l'impression d'une collection de tranches de vies Américaines, au début du 20e siècle...
Production de prestige s'il en est, ce film n'est bien sûr pas tout à fait un long métrage réalisé par cinq réalisateurs de renom... C'est l'une anthologie de cinq adaptations de nouvelles de O.Henry, écrivain immensément populaire dont la Fox a souvent tiré des films... Et afin d'assumer le prestige jusqu'au bout, le producteur Andre Hakim a demandé à John Steinbeck lui-même de faire des apparitions dans le film, pour y introduire chacune des histoires. les ambiances sont fort différentes d'un court métrage à l'autre, en fonction bien sur du ton de chaque nouvelle. Mais la compagnie a vraiment mis les petits plats dans les grands en convoquant un casting de rêve... Comme toute anthologie, le film a ses hauts et ses bas, c'est a raison pour laquelle je vais, de façon succincte, plutôt me livrer à une brève description et une courte critique de chaque segment. Pour le reste, le film réussit bien à donner l'impression d'une collection de tranches de vies Américaines, au début du 20e siècle...
The cop and the anthem (Réalisé par Henry Koster, écrit par Lamar Trotti)
Un clochard, interprété par Charles Laughton, décide de se faire arrêter, car l'hier approche... Hélas! il semble que l'humanité soit un peu trop compréhensive pour lui...
Le film se devait de commencer fort: de fait, c'est le meilleur des cinq récits, dominé il est vrai par une prestation mémorable de Laughton... Et une rencontre brève mais fascinante: il a une courte conversation avec une jeune prostituée interprétée par Marilyn Monroe. Le récit est donc enlevé, amer et fortement teinté d'une ironie que n'auront certes pas tous les autres courts métrages du film.
The clarion call (Réalisé par Henry Hathaway, écrit par Richard Breen)
Un policier (Dale Robertson) reconnait un indice dans une affaire de meurtre, qui le renvoie à son passé... Il va retrouver une fripouille (Richard Widmark) qu'il n'a pas vu depuis sa jeunesse, et dont il a deviné qu'il avait tué la victime, et les deux hommes vont mettre toutes leurs cartes sur la table... Et même trop: le policier joue un jeu très dangereux...
On a là un bon départ vers le film noir, et l'alliance entre Hathaway et Widmark nous permet d'envisager le meilleur.Hélas, si Widmark comme d'habitude vampirise l'écran, son partenaire est un peu faiblard. On appréciera toutefois les notations acerbes sur le salaire de misère que reçoivent les policiers...
The last leaf (Réalisé par Jean Negulesco, écrit par Ivan Goff et Ben Roberts)
Une jeune femme (Anne Baxter) atteinte de pneumonie se laisse mourir, alors que sa soeur (Jean Peters) essaie de l'aider à surmonter sa maladie. la malade est persuadée que lorsque la dernière feuille de l'arbre qu'elle voit de sa fenêtre partira avec le vent, ce sera le signe pour elle de mourir. Parallèlement, leur voisin du dessus, un peintre (Gregory Ratoff), attend vainement de peindre une toile qui ait du sens...
Surprenant, le film est noir à l'extrême. Negulesco l'a uniquement filmé dans un bloc d'appartements, et on quitte rarement la chambre de la mourante. La fin est tire-larmes à souhait, mais ne manque pas de grandeur...
The ransom of Red Chief (Réalisé par Howard Hawks, écrit par Ben Hecht, Nunnally Johnson et Charles Lederer)
L'unique film court de Hawks, sera le seul segment à être coupé du film! Et pour cause: personne n'y a jamais ri... C'est pourtant assez caustique, mais on manque ici cruellement de personnages à aimer sans doute. Et le metteur en scène a probablement eu du mal à s'intéresser à cette intrigue de deux minables (Fred Allen, Oscar Levant) qui tentent un kidnapping , mais enlèvent un gamin qui va faire d'eux des victimes... Pas très professionnel.
The gift of the magi (Réalisé par Henry King, écrit par Walter Bullock)
La deuxième vraie réussite du film est ce petit conte de Noël, tendre et inattendu. A l'approche des fêtes de fin d'année, un jeune couple (Farley Granger et Jeanne Crain) regrette de ne pouvoir se faire des cadeaux dignes de ce nom, car les temps sont durs... Mais ils vont tous deux trouver des stratagèmes...
On évite les larmes, avec une histoire inattendue, qui joue sur les fétiches des uns et les sales manies des autres, sans se départir du ton tendre choisi par King. Deux aspects de chaque personnalité vont jouer un rôle déterminant: la longue chevelure soyeuse de la jeune femme, et l'obsession du temps du jeune homme. Une fin totalement appropriée pour le film...










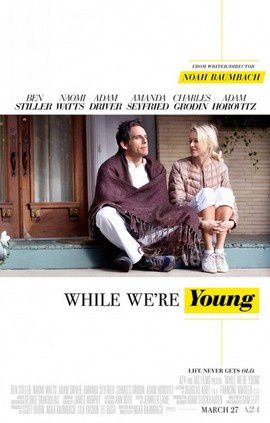
/image%2F0994617%2F20160914%2Fob_b12ab5_bluff.png)
