
Le film de Louis Feuillade, composé de dix épisodes (La Tête coupée; La Bague qui tue; Le Cryptogramme rouge; Le Spectre ; L'Evasion du mort; Les Yeux qui fascinent; Satanas; Le Maître de la foudre; L'Homme des poisons; Les Noces sanglantes) est paru entre novembre 1915 et juin 1916. Contrairement à Fantômas, et ses quatre suites (1913-1914), le film est bien une oeuvre, plus ou moins planifiée, et construite sur une histoire de combat acharné entre les forces du bien (D'honnêtes gens, journalistes, policiers, voire artistes ou anciens malfaiteurs repentis) et les forces du mal, qui font il faut bien le dire, tout le sel de cette saga, avec leur inventivité dans le crime, et leur cruauté sans pareil, décidément très cinégénique... Et le film va, volontairement ou non, se faire en filigrane l'écho des événements du front, bien que jamais une seule fois une allusion directe à la guerre ne transparaisse sur l'écran!
(Philipe Guérande (Edouard Mathé), reporter au "Mondial", livre une lutte sans merci contre la bande de malfaiteurs Les Vampires. Il est aidé en cela par son ami Oscar-Cloud Mazamette (Marcel Levesque), un ancien de la bande qu’il a persuadé de suivre le droit chemin et qui lui est très dévoué. Il ne ménage pas ses efforts pour contrer les agissements du Grand vampire, le chef de la bande (Jean Aymé), d’Irma Vep (Musidora), l’égérie des malfaiteurs, ou encore de Satanas (Louis Leubas), dangereux manipulateur d’explosifs, et Vénénos (Frédérick Moriss), le "maître des poisons"...
Les Vampires n'est pas le premier sérial Français : Victorin-Hyppolite Jasset avait réalisé les aventures de Nick Carter (1908) pour la compagnie Eclair. Avec la série Zigomar (1912), il avait poussé son expérimentation un peu plus loin en s’attachant non à un justicier mais bien à une bande de malfaiteurs. L’héroïne de Protéa (1913) était une femme, Josette Andriot incarnait une détective douée pour le déguisement. Après le succès des Fantômas, Les Vampires représente cette fois une tentative consciente et vaguement opportuniste de capitaliser sur le succès du genre serial. En particulier à cette époque, la noble Gaumont tentait de rivaliser avec la plébéienne Pathé qui distribuait alors les feuilletons américains (The Perils of Pauline distribué en France après le succès des films de Fantômas). Mais pour aller plus loin, le coté baroque des films de Jasset, la peinture d’une bande étendue de malfaiteurs unis dans le crime, avec leur hiérarchie et leur goût pour les armes, les techniques les plus diverses d’un côté et la volonté de donner un rôle important à une femme (comme cela avait été fait dans Protéa) d’autre part ont certainement joué un rôle dans la conception des Vampires.
Le mode de fonctionnement de la série tourne entièrement autour de quelques clous, comme on disait alors : évasion spectaculaire, meurtre élaboré, coup de théâtre... Par moments, on pourrait soutenir que le titre (La Tête coupée, La Bague qui tue...) est venu avant l’histoire, et c’est probablement souvent le cas, mettant en lumière une recherche de l’effet immédiat sur le spectateur. La narration, linéaire, est ancrée du point de vue de Guérande jusqu’au troisième épisode, lorsque Feuillade s’autorise à partir d’une scène qui montre la préparation d’un mauvais coup par les bandits, ce qu’il fera de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Une fois établies clairement les différences entre Guérande et les Vampires, il n’y a plus de barrière morale à montrer les agissements des malfaiteurs dans leur quotidien ! Le style visuel des Vampires est à la fois simple et direct, et repose souvent sur des images devenues depuis mythiques. Dans Les Yeux qui fascinent, Feuillade montre une séquence d’une grande beauté, d’un baroque assumé et qui louche clairement du côté du fantastique pur: les Vampires ont décidé de faire un gros coup et ont donné rendez-vous à toute la bonne société. Une fois la fête lancée, les Vampires se retirent, asphyxient tout le monde, et une fois chaque convive endormi dans la pièce sombre, deux portes s’ouvrent au fond du cadre dans lesquelles se détachent les silhouettes de vampires en collants noirs : les bandits vont pouvoir se servir sur leur victimes et les délester de tous leurs bijoux, portefeuilles et montres... La puissance onirique d’une telle scène doit beaucoup à l’incarnation trouvée par Feuillade pour le crime, le mal, le mystère, ces inquiétantes silhouettes qui échappent à toute rationalité (pourquoi d’ailleurs se grimer ainsi si les victimes endormies ou mortes ne risquent pas de reconnaître les bandits ?). Ces déguisements sont pour Feuillade aussi bien un geste artistique qu’un signe de reconnaissance, qu’une échappée de l’inconscient, surtout lorsqu’il joue de la silhouette sensuelle de Musidora, seulement habillée d’un collant plus que révélateur.
Guérande et Mazamette, les héros en titre du film, sont deux personnages bien différents l’un de l’autre. Deux archétypes, d'ailleurs: Edouard Mathé, le reporter, est un solide gaillard, droit dans ses bottes, qui avance du début à la fin sans jamais laisser le doute s’installer en lui. Il a une intelligence particulièrement aiguisée, le fruit d’années à lutter contre le crime, et a acquis une solide réputation grâce à ses enquêtes et reportages, ce qui fait de lui un notable. Ses entrées à la police, sa solide position de reporter-vedette, ses amitiés haut-placées (la danseuse vedette Marfa Koutiloff avec laquelle on lui prête une liaison, par exemple) font de lui un homme situé du bon côté de la loi et dans la bonne frange de la société. On ne peut s’empêcher de se dire qu’il doit être d’un ennui mortel... Il lui fallait donc un faire-valoir à la hauteur: Marcel Levesque deviendra une grande vedette après son interprétation d’Oscar-Cloud Mazamette, dont l’évolution dans le film trahit le côté instable, les ennuis économiques (un fils, parfois trois, à nourrir, un travail à trouver coûte que coûte) mettant en valeur son appartenance à une classe sociale défavorisée. Ici s’arrête la lecture socio-économique, car si Mazamette est dans le premier épisode un membre des Vampires, c’est certes par nécessité, mais c’est surtout parce que cela va bien servir le scénario: lorsque Mazamette habillé en Vampire découvre que l’homme prisonnier qu’on lui fait surveiller n’est autre que Philippe Guérande, qui a été bon avec lui, il n’écoute que son cœur et passe à l’ennemi. Désormais, le brave homme sera du côté de la loi, et trouvera du travail, avant de devenir riche à la faveur d’un épisode. Mais sa simplicité et son physique, ses constants clins d’œil au public font de lui un personnage burlesque qui allège les aspects sentencieux, pudibonds et ennuyeux de son copain Guérande, l’homme du monde qui vit chez sa mère jusqu’au cinquième épisode !
Jusqu’au quatrième épisode, la situation est relativement simple, renvoyant systématiquement à Guérande et Mazamette contre les Vampires... avant l’apparition de Juan-José Moreno. Celui-ci, interprété par Fernand Herrmann, est un bandit qui n’appartient pas à la bande des Vampires et qui va non seulement renouveler les combinaisons de scénario, mais aussi permettre de continuer à peindre les aventures des Vampires de l’intérieur sans pour autant risquer les foudres de la censure, la compétition avec Moréno devenant parfois plus dure encore que la lutte contre le vertueux Guérande.
La Gaumont, ainsi que Feuillade, allaient être accusés de faire l’apologie du crime avec cette série, depuis la vision fascinée d’un «Vampire» masqué qui échappait à la police en marchant lentement sur les toits de Paris, jusqu’à un final en forme de baroud d’honneur dans lequel ils luttaient jusqu’à la mort. Apologie, non, mais véritable fascination, la présentation du crime dans les films de Feuillade doit tout à une volonté innovante de synthétiser l’image du mal à travers des vignettes fortes qui ne sont pas réduites qu’à des concepts vagues. Une certaine idée de la liberté de faire ce qu’on n’a pas le droit de faire semble bien être ce qui différencie l’homme droit, vertueux et honnête (Philippe Guérande) et le Vampire : tuer, voler, enlever, menacer, hypnotiser, tirer au canon, se rendre complice d’une évasion spectaculaire, se faire passer pour d’autres... les figures libres du crime tel qu’il apparaît dans ces films ne manquent pas. Mais il ne s’agissait pas pour Feuillade de glorifier, juste d’exagérer le mal jusqu’à le rendre particulièrement "photogénique".
Produit en pleine guerre dans un studio qui menaçait de devoir tout arrêter, Les Vampires était sans aucun doute considéré comme un film économique pour la Gaumont. D'une certaine manière il représente comme une régression pour Feuillade. Mais celui-ci a eu tout le loisir d’y recycler des leçons de ses anciens films: Fantômas, mais aussi pour une large part les films sensationnels de La Vie telle qu’elle est, ou des sujets crapuleux comme Le Trust. Il a aussi pu y développer un style propre qui a eu une influence considérable sur d’autres cinéastes. Le côté "gratuit" des films a par ailleurs séduit les surréalistes et a beaucoup fait aussi pour la pérennité des Vampires. Pourtant, il m’apparaît quand même que le déroulement de la série obéit à une certaine rationalité. Il aurait sans doute été de mauvais augure de tout faire reposer sur un moment de suspense qui aurait certes mis tout le monde en haleine, mais pour Feuillade qui avait dû renoncer en 1914 à poursuivre la série de films qu'il avait imaginés autour de Fantômas, il devait être important de pouvoir retomber sur ses jambes à chaque fin d’épisode... L’improvisation a parfois été la règle, et certaines traces en restent dans le côté arbitraire de certains coups de théâtre: lorsque Jean Ayme, méchant en titre, a commencé à se comporter en star, on a purement et simplement tué son personnage (Les Yeux qui fascinent). Moréno, dans un premier temps, est un bandit opportuniste qui n’a aucune envergure mais beaucoup d’intelligence et de réactivité. Avec le bien nommé Les Yeux qui fascinent, il va devenir (par la grâce d’un intertitre) un homme inquiétant doué de talents particuliers pour l’hypnotisme, ce qui lui permet de pousser Irma Vep à tuer le grand Vampire, mais ce qui lui donnera aussi l’occasion d’enlever la jeune femme et l’attacher à lui... Les différents changements de "patron" des Vampires sentent eux aussi l’improvisation, ou une façon de rappeler à l’ordre les acteurs qui se sentiraient pousser trop d’importance. Une dernière trace de cette tendance à l’improvisation figure dans le recyclage sans vergogne d’un film inachevé tourné en Camargue, qui met en scène Renée Carl: pendant qu’Irma Vep va fouiller une chambre d’hôtel, son complice raconte une histoire qui tient tous les convives en haleine, permettant à Feuillade d’introduire son petit fragment de film.
On ne doit pas oublier que ce film profondément délirant (un quidam y menace les gens de son canon qu’il utilise pour couler un navire à distance; un stylo empoisonné est utilisé par une sexagénaire pour s’échapper alors qu’elle est retenue prisonnière, e tutti quanti...) a été réalisé pendant la guerre et devait probablement avoir pour mission, non pas de sauvegarder le moral des troupes mais bien plus de permettre une échappatoire à ses spectateurs. Néanmoins, le final de la série se devait aussi de montrer comment les honnêtes gens allaient savoir serrer les rangs devant une adversité rompue à tous les actes sadiques. Le dernier épisode, Les Noces sanglantes, survient après de nombreuses péripéties qui vont voir Musidora-Irma Vep passer de mains en mains, de bande (Vampires) en bande (Moréno). Mais il est intéressant de voir d’une part que Feuillade va faire en sorte que cet ultime chapitre se termine sur une action musclée des forces de l’ordre qui vont faire subir à la bande de Vep et Venenos le même type de traitement qu’eux-mêmes ont asséné à toutes leurs victimes : c’est lors d’une crapuleuse cérémonie de mariage que les policiers, emmenés par Mazamette et Guérande, vont massacrer les Vampires... je passe sur la description de l’assaut, surprenant par son côté expéditif, que vous pourrez aller voir par vous-mêmes dans le film. Il est troublant de voir que Fritz Lang s’en est probablement inspiré pour son final de Dr Mabuse der Spieler, six ans plus tard. Mais surtout, Guérande et Mazamette ont déployé les grands moyens pour une raison bien précise : deux femmes ont été enlevées. L’une (Jane-Marie Laurent) est la jeune épouse de Philippe Guérande, l’autre (Germaine Rouer) une jeune veuve (son mari, le concierge de la famille de la jeune Mme Guérande, a été empoisonné par les Vampires !) que convoite le sentimental Mazamette. Seule survivante de l’assaut, Irma Vep passera quelques minutes seule avec les deux femmes, dans la cave où elles ont été emprisonnées, les tenant en son pouvoir du moins le croit-elle. Quand Guérande et Mazamette arriveront, il sera trop tard: l’une des trois femmes sera morte. Pour ce final sans doute planifié, Feuillade abat ses cartes et, comme Lang quelques années plus tard, fait intervenir pour terminer son film la cave sombre d’une maison assiégée, trois femmes livrées les unes contre les autres, des héros fondamentalement impuissants à y faire quoi que ce soit, et un destin scellé dans le crime... Un final qui non seulement offre à la Gaumont une revanche musclée des forces de l’ordre sur les nombreux crimes des Vampires, mais aussi un message subliminal sur l’importance des femmes dans ce film hors du commun, qu’elles soient honnêtes ou criminelles.
Les Vampires a sans aucun doute révolutionné, voire recréé le cinéma de genre en France, et pas seulement. Nombreux sont les films de Lang, par exemple, qui renvoient aux canevas de rêve éveillé des Vampires, aux associations de scènes mises bout à bout qui forment un excitant parcours du combattant dans l’inconscient : Ministry of fear et son improbable itinéraire vécu par un Ray Milland en proie aux espions, sous toutes les formes les plus inattendues, se situerait assez bien dans la continuité des Vampires. Feuillade a libéré un cinéma assez conservateur de ses réserves dans la peinture du crime en action. Il a su créer des signes cinématographiques (là encore on s’en voudrait de ne pas penser à Lang ou Hitchcock) grâce à Irma Vep, grâce à Moréno et ses « yeux qui fascinent ». Le film à épisodes a aussi contribué à capter de façon sûre l’esprit d’une époque, non dans son art officiel et consacré mais dans ses plaisirs coupables, à l’instar de ces scènes situées dans le beuglant ou les Vampires se retrouvent pour écouter les imprécations de la chansonnière Irma Vep avant de descendre à la cave pour y regarder les mêmes danses des Apaches (un homme et une femme qui miment la comédie de l’amour brutal !)... Bien sûr, pour la conservatrice Gaumont et le royaliste Feuillade, toutes ces canailles sont une incarnation populaire du mal, généralement situé du côté de la racaille et du bas peuple. Mais Feuillade a aussi su, grâce à Mazamette qui est lui aussi un travailleur, éviter de dépeindre un univers trop manichéen. Et si Guérande est toujours du bon coté de la police, un représentant typique de la bourgeoisie, il est aussi amené dès le premier épisode à faire face à une police qui ne souhaite pas lui accorder le temps qu’il mérite (La Tête coupée). En revanche, il se rend compte de la facilité qu’ont les Vampires d’infiltrer la bonne société, justement... Tout en ménageant les couches les plus conservatrices de la société de 1916, Feuillade introduit comme en contrebande une vague idée de corruption de la société Française. Ce qui débouchera avec Judex, le serial suivant, sur une plus grande implication de la Gaumont pour une vision beaucoup plus tranchée du monde!
Enfin, comment ne pas voir que dans ce film, les méchants ont accès à un arsenal de la plus grande modernité? Masques à gaz, poisons élaborés, canons spectaculaires, et les Vampires sont organisés comme une armée... En creux, dans son portrait d'une époque, Feuillade n'a pas oublié de faire passer l'idée d'une guerre qui décidément, s'attardait... En attendant, Les Vampires est un authentique chef-d’œuvre, né par hasard d’une volonté de faire du cinéma au rabais... On aurait envie de dire que c’est raté, tellement la supériorité de ce film à épisodes sur tant de ses contemporains est évidente.











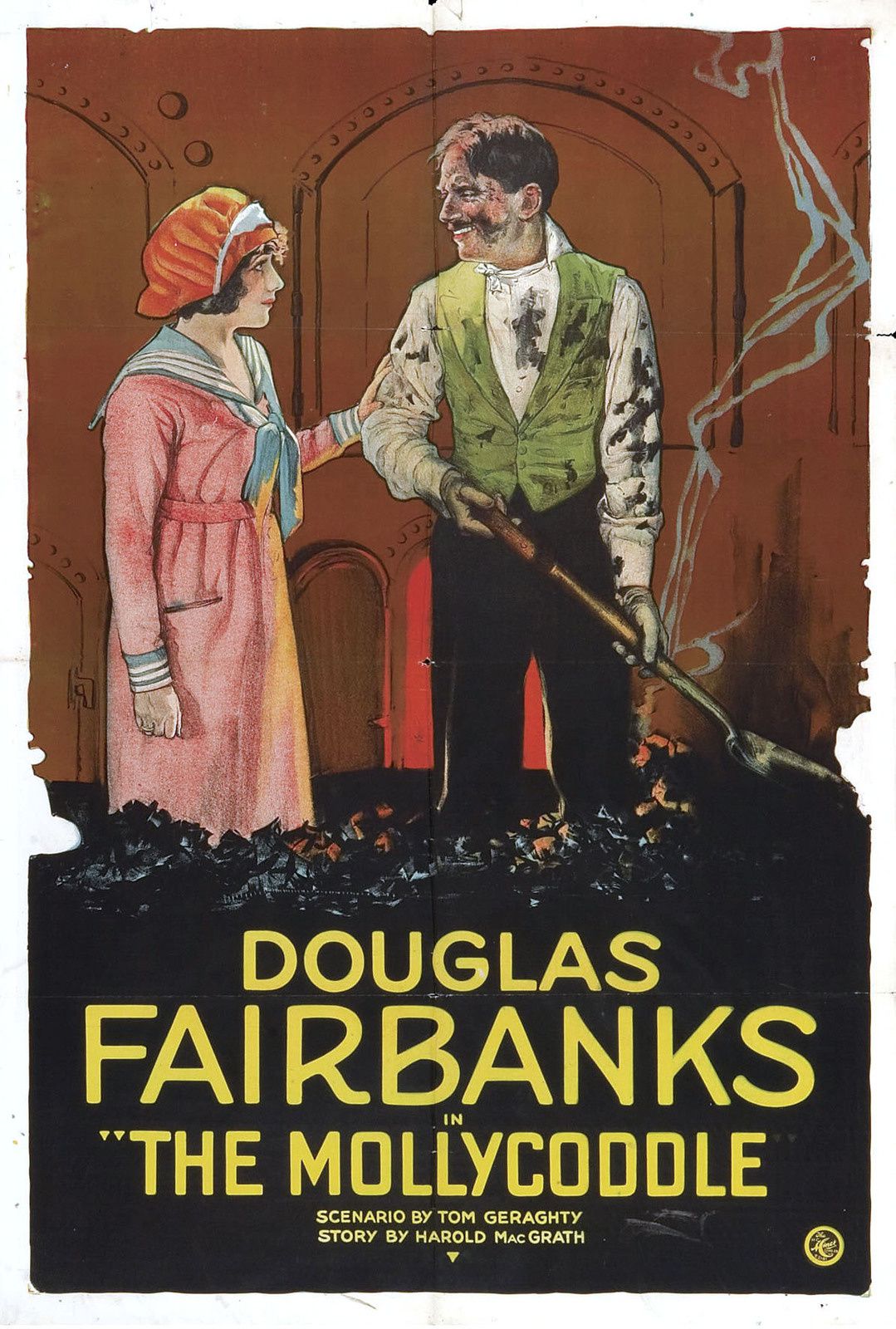


/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_1cdf32_51619-3.jpg)
/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_64b411_3147429634.jpg)
/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_bdc2ca_50001359131-c6d865e294-b.jpg)
/image%2F0994617%2F20221021%2Fob_162508_casanova1927-imperatrice.jpg)



/image%2F0994617%2F20210502%2Fob_417a04_a1e886b431370191531a99069342790f.png)
/image%2F0994617%2F20210502%2Fob_8b5bd3_big-parade.jpg)
/image%2F0994617%2F20210502%2Fob_1181cd_bigparade-attack-fc-470x264-0527201609.jpg)
/image%2F0994617%2F20210502%2Fob_2cf33d_thebigparade-johngilbertreneeadoree.jpeg)
/image%2F0994617%2F20210502%2Fob_3eb8d5_201411110000984.jpg)

/image%2F0994617%2F20141207%2Fob_1cd8e2_spies-1-copy.jpg)
